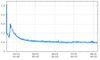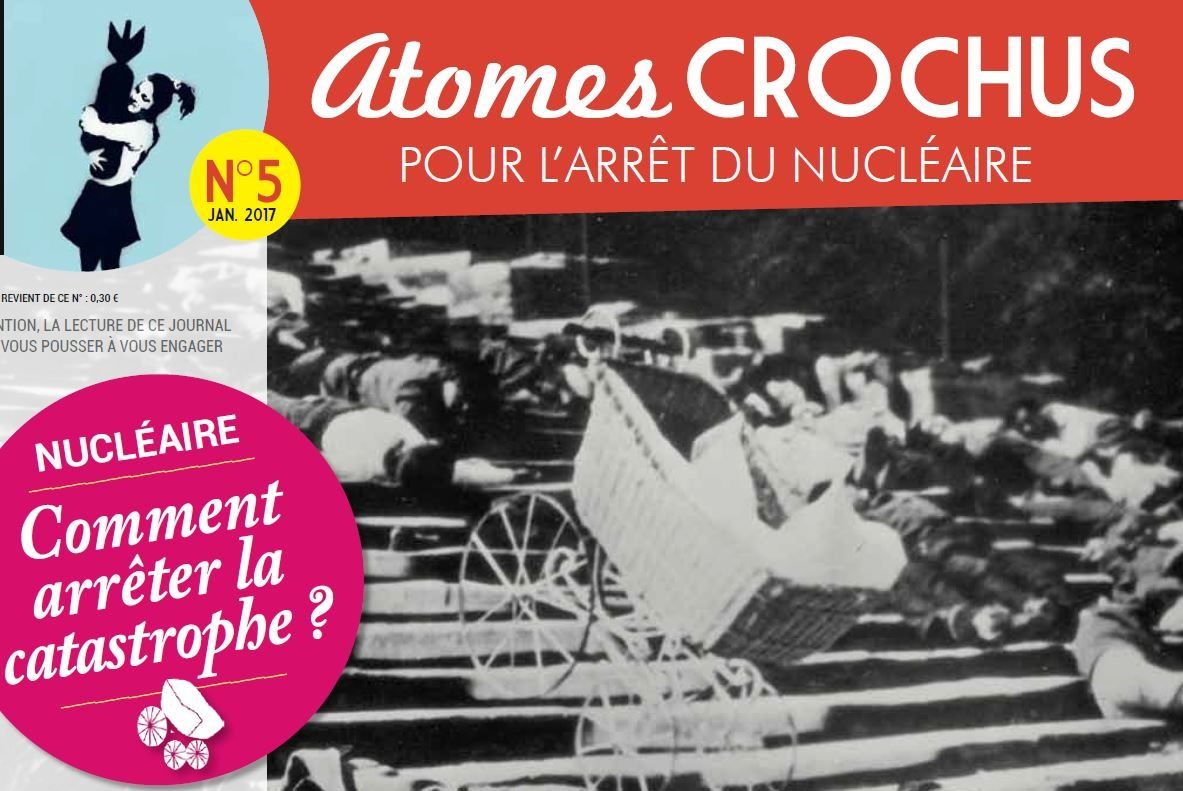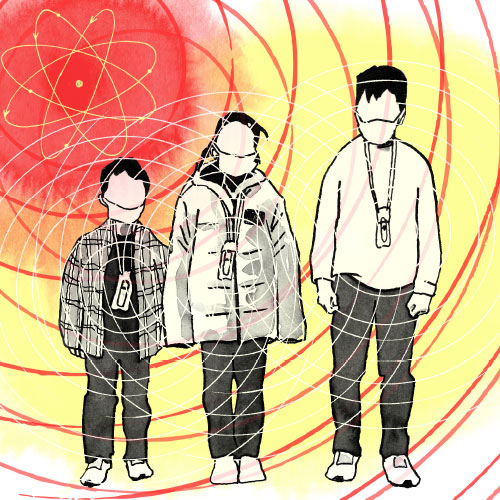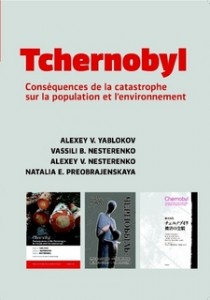Le 16 août 1943, en pleine intensification de la Guerre, la Préfecture de Tokyo ordonne de mettre à mort, en toute urgence, et par tous les moyens possibles, certains animaux du zoo de Ueno, à Tokyo.
Raison officielle du projet d’abattage : la protection des habitants de Tokyo. À savoir, prévenir la panique des civils, si d’aventure une bombe de l’Armée américaine venait à détruire les cages du zoo et à libérer les animaux les plus dangereux (éléphants, lions, tigres, panthères, léopards...). Ceux-ci, affamés et furieux, pourraient errer dans la ville et attaquer les citoyens. Risque impossible à courir. D’où cette décision impérative des autorités : « mettre fin en douceur » à la vie des bêtes.
Raison cachée : des frais d’entretien animalier (nourriture, soins) trop élevés. De plus, à cette époque, les bombardements massifs sur Tokyo n’ont en réalité pas encore commencé. Si les Japonais sont soûlés de récits guerriers victorieux contre ces « démons d’anglo-américains », la vérité est que la défaite est plus précise jour après jour. La possibilité de raids aériens alliés, chargés de bombes incendiaires, est de plus en plus certaine. Par voie de conséquence, sacrifier les animaux permet de créer un « choc psychologique » qui suggère aux civils l’éventualité d’un bombardement futur. L’Armée peut ainsi, de cette manière contournée, appeler la population à la défense, sans se départir de l’habituelle rhétorique triomphaliste et martiale.
Recensement des bêtes :
9 ours (ours du Japon, ours polaires, ours malais)
3 lions
1 tigre
7 panthères, guépards et léopards
2 serpents (1 python et 1 crotale)
2 bisons d’Amérique
3 éléphants (John, Tonky et Hanako)
Méthode de mise à mort :
La strychnine est fournie par les services de l’école vétérinaire de l’Armée. Mêlée à la nourriture, elle atteint son but, la mort de l’animal, dans la plupart des cas (ours, lions, léopards). Cependant, certains pensionnaires du zoo refusent de manger les rations empoisonnées.
Des mesures directes d’exécution ont donc été mises en place. On ne se résout pas à utiliser les armes à feu, de peur de « heurter les sentiments des résidents proches du zoo ».
Le python est décapité au scalpel.
Le crotale a la tête percée d’un câble, puis est traîné par le cou avec un fil de fer chauffé à blanc. Comme cela ne suffit pas, seize heures plus tard on le garrotte solidement avec un filin. Asphyxie.
Les deux bisons sont entravés dans des filets, puis achevés à coups de marteau et de pioche dans la boîte crânienne.
Les gardiens jettent des filins autour de la gorge d’un ours japonais (affaibli par trois jours de jeûne). Ils se mettent en groupe de cinq et tirent de toutes leurs forces jusqu’à suffocation de l’animal. L’opération est répétée sur un des ours polaires, avec un câble métallique.
Un piège étrangleur à lacet a été mis dans la cage de la panthère noire. La mort par asphyxie survient au bout de 4 minutes et 30 secondes. Même protocole pour le guépard.
Différents essais ont lieu afin d’abattre les éléphants. Ils refusent les pommes de terre empoisonnées à la strychnine. Une injection létale hypodermique est envisagée, mais la peau dure des pachydermes décourage les tentatives. Les jeux de cordes, qui se sont révélés si efficaces pour les autres mises à mort, ne résistent pas à la force des éléphants.
Cependant, ils doivent mourir. Quelles que soient les réticences ou les difficultés. C’est une question de force majeure. Une nécessité de la guerre.
Alors, même si cela doit prendre des semaines, on décide de laisser les trois éléphants mourir de faim. Du jour au lendemain, les repas sont suspendus. John, Tonky et Hanako croupissent dans leurs cages, leurs stéréotypies se font plus lentes, ils finissent par se figer ; ils vacillent, et s’effondrent. Au final, leur agonie aura pris un mois.
Et puis un jour, les Maîtres ne vinrent plus...
***
Et puis un jour, les Maîtres ne vinrent plus.
Nous attendons. Patiemment. D’habitude, il y avait une interruption dans l’espace de temps entre les visites. Visite égale nourriture. Mais à présent, rien. Personne. Nous attendons. Et nous commençons à avoir faim. Dans cette vie morne et éteinte, l’absence d’un événement est déjà un événement.
À la place, la sirène : meuglement sonore dans l’air, déchirure, agitation palpable, là-bas, au-delà du champ de vision. Mais ici, rien ne change.
La nuit est tombée. Une nuit froide et glacée. Bruine. Dans l’obscurité, notre faim grandit. C’est comme un acide qui nous ronge le ventre : comme si quelque chose mord à l’intérieur. Ça grignote. Nous crions, solitaires, dans le noir. Nous nous serrons les unes contre les autres, sans comprendre. Offrant la compassion de nos peaux frottées. Les yeux humides remplis d’ombre.
Puis vient le matin. Une petite aube blême, interminable. La lumière n’en finit plus de s’autoinfuser. La clarté se fait enfin, mais nous ne la remarquons plus.
Ce jour-ci encore, les Maîtres ne vinrent plus. La caresse du gant sur le museau. Les bauges remplies, les bouches qui mastiquent à grand bruit. Le contact rude des pompes métalliques qui viennent empoigner les pis, les tirent, soulagent la pression des mamelles en faisant gicler le lait. Le souffle de l’Autre, à la fois grand sur ses deux pattes, et minuscule face à notre corpulence de vaches. Aucune de ces sensations familières, pas toujours agréables. Plus rien ni personne. Incompréhension.
Alors, on attend. La faim est partout : dans la glu de la terre humide. Dans chaque goulée d’air. Dans le froid et la neige qui tourbillonne. On dirait un grand vol de papillons de toutes les couleurs qui s’échappent d’une grande plaine verte, verte à s’en faire péter les dents à force de brouter. La langue à présent a pris le goût métallique de la faim. Pâte molle, serpent de chair sec, elle tape contre le palais. L’obscurité revient.
Le lendemain, pas de Maîtres.
Titubantes, nous ne pouvions plus bouger : nous étions entièrement dépendantes des Maîtres pour la nourriture, alors que nous ne demandions presque rien pour vivre, juste de sortir de cette prison, juste mettre les pieds sur de la terre vivante... Si seulement ce loquet pouvait bien pivoter : nous serions libres. Et cette liberté que nous n’avions jamais poursuivie devenait la clé de la survie, car la liberté, c’était la nourriture, la bouillie tombée divinement sur les intestins, et mâchée encore et encore, elle revient, on n’en finit jamais de la digérer avec délices. Nous avons les pieds dans notre merde, nous la léchons avec application pour y trouver le souvenir nostalgique de l’herbe.
Le lendemain, pas de Maîtres.
Nous nous agaçons mutuellement, l’œil rendu fou par le manque. Ça grimpe, ça ne s’arrête plus : nous sommes terrassées par la faiblesse, le temps devient un ennemi, un ennemi implacable. Là où nous explorions doucement les domaines de la satisfaction (le grand pré, l’herbe toujours abondante, le manger, le manger), nous avons à présent perdu la seule chose qui nous faisait exister. Nous sommes devenues tronquées, diminuées. Certaines tapent du museau contre la palissade, espérant la briser. D’autres se sont abîmées dans la contemplation interne de pâturages infinis et abondants, obsédées par l’image vivante de l’herbe, du foin frais, elles claquent des mâchoires. Bruit sec, bientôt imité. Et ce bruit nous rappelle la béance, la nourriture lointaine. Toutes nous sommes touchées, liées solidement, garrottées entre nous par notre famine insupportable.
Les hallucinations reviennent. Du foin, la chaleur qui coule dans le gosier. Absence. Froid.
Et par trouées, la colère, terrible, insondable : nous meuglons encore et encore, tentant d’extirper la bestiole qui nous dévore les tripes, de casser la mélodie fade de la faim. Les jambes sont de plus en plus faibles ; la respiration, entrecoupée.
Nous avions l’impression de nous enfoncer dans le sol. Nous tombions ; naufrage lent, vol plané interminable sur place. D’aucunes se tapaient la tête par terre. Nos meuglements redoublaient d’intensité, nous nous remplissions de nos cris solitaires, désespérés, furieux. À manger. À manger. À manger. Rampant le long d’un couloir sans fin de temps, glacées, agitées, suppliantes, nous tanguions contre la nuit. Certaines étaient déjà mortes. Nous n’avions jamais autant aimé et détesté les Maîtres, ils nous avaient abandonnées, qu’avions-nous fait, le monde est un grand cri noir, les mamelles sont des clous remplis de lait caillé, la peau se rapproche dangereusement des os, organes tourmentés, impossibilité de se tenir debout, des aiguilles dans l’estomac, la queue comme dernière corde de survie. Tout autour : des bruits de chute.
... Je suis restée la dernière debout.
Je passe ma dernière nuit. Je suis épuisée, la tête lourde comme les pierres, la pensée déjà revenue à l’immobilité, les sensations englouties dans l’empire énorme de la faim. Je n’ai déjà presque plus de voix. Ce n’est plus des appels à l’aide, c’est déjà une élégie, un service mortuaire ; et en même temps, mes hurlements sont la dernière preuve que je vis encore, qu’il y a encore une épine de vie, une petite étincelle qui continue de lutter, par-delà le froid intense, les frissons, les montées de bile, les yeux vitreux rendus au néant. Ma voix est le dernier crampon qui me rattache au monde : si je me tais, je meurs. Alors je meugle, de plus en plus faiblement.
Puis ma voix mourante s’éteint tout à fait. Elle avait été en fin de compte anéantie par la mastication lente et interne des milliers de dents dans ma gorge. L’équilibre me quitte. Je bascule lourdement sur le côté. Le nez dans la boue, je sens que la galaxie est un champ d’herbe, verte, fraîche, couverte de rosée, une couleur éclatante, lumière céleste qui me fait courir la peau de spasmes. Et sous mon regard extasié, je vois très nettement une masse immense élevée dans l’air pulvérulent : un Himalaya de charognes, entassement monstrueux de centaines de milliards de semblables, gros ou petit, éléphants ou musaraignes : animaux amaigris, le poil détruit, la peau malade, les yeux chassieux, harcelés par les mouches, aveugles, frappés, torturés, façonnés, à jamais crevés par la main même de l’Autre. Partout, dans cette Arche inversée, on trouve les mêmes traces, les mêmes stigmates : l’incompréhension, le regard qui se dérobe, le sang qui coule, la panique et la mort, les cris, les machines. La frénésie puis le renoncement, la vie qui fuit de partout, des pores, des yeux, de la gueule, de l’anus, du cou, ventres ouverts par les infinités des lames. Face à cette montagne de chair fermentée, lourde et odorante, je ferme mon regard et mon esprit.
Et je meurs enfin.
***
Et après.
Sous le vent qui recourbe les graminées redevenues sauvages, le ciel gris commence silencieusement à pisser. Une vaporisation plutôt qu’une pluie, à vrai dire.
Mme Morita regarde la bouverie de la ferme Tanaka. Les bêtes sont toutes mortes. Toutes. Il y a ici plusieurs dizaines de vaches. Dinosaures échoués, la gueule dans la boue, la langue jadis tirée fondue dans la terre. Elles pourrissent. C’est ce qu’est devenu Iidate-mura : une ruine, un cimetière, où la vie se retire. C’est comme cela ici, et c’est pareil ailleurs.
Un chien maladif passe honteusement sous la bruine. Abrité dans l’auvent du hangar, Mme Morita l’appelle gentiment, en patois du nord, celui-là même qui n’est plus parlé par les jeunes.
(Et maintenant, il n’y a même plus de jeunes... Une débandade généralisée devant la menace. Dans un petit nombre de villages de la région, il reste juste encore une confrérie de vieux et vieilles revenus ici pour mourir. Sur le terrain même de leurs familles. Les dernières sentinelles, le visage ravagé et le dos cassé. Un sourire de torturé au coin des lèvres, pourtant. Mme Morita est de ceux-là).
Elle pose l’écuelle par terre, en continuant d’appeler le chien. L’animal, les yeux agrandis et les pattes emmêlées, se précipite. Il mange goulûment, avec bruit. Elle passe la main dans la fourrure sale et constellée de croûtes.
Celui-là a de la chance. Il est encore vivant. On a retrouvé des dizaines de chiens crevés de faim et d’angoisse dans les maisons abandonnées : incapables de sortir. Un chien s’est presque sectionné la carotide à force de tirer sur son collier pour se libérer. Il avait la gorge à vif, charnue comme des génitoires de femme. Il avait fini par mourir, évidemment. Obscène dans sa pose mortuaire. Il y a les carcasses de chats aussi. Les griffes en sang à force de gratter la porte pour sortir. Et les milliers de bœufs, les milliers de porcs, les centaines de milliers de poussins devenus une mélasse jaunâtre dans les hangars d’élevage. Tous morts de faim et de soif, s’étant débattus jusqu’à l’extrême de leurs forces.
Tout cela, Mme Morita l’a vu. De même qu’elle a entendu les messages officiels :
C’est un cas de force majeure. Il n’y a pas d’autre choix que d’enfermer les animaux, pour les empêcher de disséminer la contamination partout. Il est strictement interdit de les toucher, ni d’ouvrir la porte de leur enclos. Pour limiter la contamination, pour la sécurité de la population, il est nécessaire de laisser les bêtes enfermées mourir en douceur. Pour préserver notre futur à tous.
Elle était venue trop tard. Évacuée à toute force lors de la catastrophe, elle n’avait décidé de se rapatrier dans sa vieille maison que des semaines après. Tous les élevages étaient à ce moment devenus des dépotoirs de charognes. Si elle était venue plus tôt... Juste un loquet à pousser, et les vies auraient été sauvées. La culpabilité lui essorait le cœur.
Alors à présent, elle préfère arpenter la Zone pour nourrir les animaux survivants. C’était toujours mieux que de se décomposer, enfermé, dans des préfabriqués mal isolés, où certains évacués, des personnes âgées comme elle, sans famille, sans maison, sans aucune perspective que le décès, attendent patiemment que le temps passe en rêvant infiniment de réunions de famille, pleines de miel et de petits-enfants, avec la léchure du vent, la caresse de l’extérieur.
Derrière, Mme Morita entend des pas. C’est le journaliste de la NHK, qui a tenu aujourd’hui à venir avec elle. En bottes blanches, sans masque, la casquette sur le crâne. Il regarde son instrument de mesure. Puis il dit à la caméra : « ici, les niveaux sont comparativement bas ».
Mme Morita a le regard qui flotte. Elle aperçoit là-bas, sur le parking abandonné, un troupeau de moutons qui circule sur l’asphalte. Elle les connaît bien. Les ovins ont été rendus à la liberté, et donc à la vie, par un éleveur plus miséricordieux que les autres, à l’heure de l’évacuation. En deux ans, aucun agneau n’a pu naître : les fausses couches monstrueuses se sont multipliées. Seule a vu le jour une petite bête chétive, incapable de tenir sur ses pattes, la fourrure comme brûlée au napalm, le museau déformé. Elle n’a pas vécu. Mme Morita l’a enterrée dans le jardin de sa maison (au niveau comparativement bas aussi). Ce jour-là, sans qu’elle sache pourquoi, elle avait longuement sangloté sur la tombe improvisée. Allons, ce n’est qu’un mouton...
La vieille dame met sa main osseuse et tordue sur le dos du chien qui finit de lécher l’écuelle. Elle le caresse gentiment. L’animal est troublé : sur sa fourrure passe le souvenir d’un temps ancien, enfoui, où l’Homme était présent, où l’animal connaissait et appréciait sa présence. Où le regard de son maître sur lui le faisait exister, vibrer au monde. Il remue la queue. Il sourit presque. Accroupie, Mme Morita lui souffle à l’oreille :
« Vis, toi. Vis. »
Les yeux de la vieille dame s’humectent. Ils sont chauds et mobiles dans le visage plissé, semblable à celui d’une tortue.
On entend au loin, sous la pluie, la sirène de la centrale. La terre se met à trembler un peu.
La Guerre a recommencé. Si elle a jamais cessé.
/image%2F0547739%2F20150425%2Fob_895201_p73site-779x389.png)


/image%2F0547739%2F20140615%2Fob_c70a7c_kjima-jpg)
/image%2F0547739%2F20140222%2Fob_6a8304_dessin-cyril-jpg)
/image%2F0547739%2Fob_bc728f_le-deuxieme-evenement.jpg)

/image%2F0547739%2F20210208%2Fob_2b8fba_capture.JPG)
/image%2F0547739%2F20210219%2Fob_199e1f_bd-galic.jpeg)
/image%2F0547739%2F20240429%2Fob_790ad1_screenshot-2024-04-29-at-10-26-05-etud.png)
/image%2F0547739%2F20210321%2Fob_156e07_fwip.JPG)